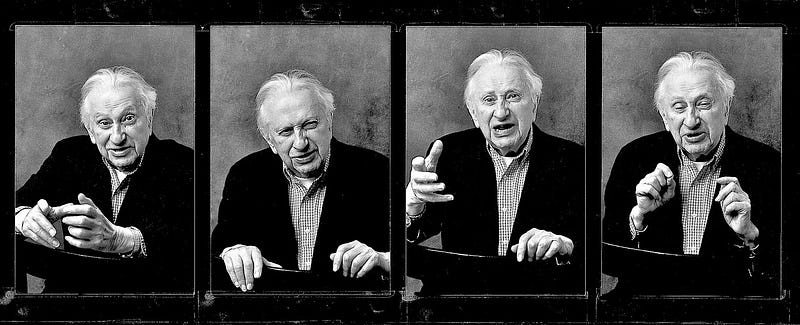La culture Jamaïcaine a influencé durablement la musique populaire mondiale depuis les années 50. Du calypso au ska, du reggae roots aux premières heures du hip hop, du punk au dubstep à l’électro minimale, son ombre plane, basses en avant : le DJ et le MC sont des inventions jamaïcaines, les sound-system, le rude-boy et la culture skin aussi. Pourtant, c’est une image tronquée de l’île et de ses habitants qui demeure dans les esprits internationaux. Influencée par une méconnaissance de l’histoire contemporaine de l’île, il ne reste dans les têtes que la réinterprétation à l’occidentale de la figure du rasta, une sorte de versant moderne du bon sauvage cool et universaliste, version fumeur de joints. Plongée en plusieurs parties dans la culture musicale et la politique de l’ancienne île boucanière.
Article écrit avec Grégory Pierrot [1].
Un ami américain nous faisait récemment part de ses impressions lors de sa première visite en Jamaïque. C’était la deuxième fois, mais la première fois que notre chercheur universitaire y rencontrait des gens et y faisait autre chose que d’explorer les archives, et il était bouleversé. Pourtant, les Américains vont à la Jamaïque comme les Lorrains vont en Allemagne, c’est juste à côté, c’est globalement moins cher, on y parle une langue qu’on comprend plus ou moins mais le touriste y étant roi, le local fait des efforts pour calmer son accent.
Les étudiants ricains descendent sur la Jamaïque comme la peste à chaque Spring Break, venant dorer leurs fesses blanchâtres et adipeusesau doux soleil caribéen, se saouler au punch planteur dans des complexes tout inclus entourés de barbelés où ils arrivent direct de l’aéroport et d’où ils repartiront de même, repus, appareils photos pleins de sourires impérissables.
Foutez-vous de leurs gueules, et rappelez-vous des commentaires de vos potes partis revenant de la Martinique. Les Antilles, c’est si bien quand on n’y voit pas de pauvres. C’est le slogan du tourisme local, et tant qu’on peut, on s’y prête.
Seulement voilà, notre ami était à la Jamaïque pour une conférence organisée par les marrons de Charles Town , une communauté d’esclaves échappés ayant gagné de haute lutte leur indépendance et obtenu un traité de paix avec l’Angleterre au dix-huitième siècle.
Plutôt que de voir le Reggae Sunsplash Festival, l’ami a eu droit à un coup d’oeil sur la réalité sociale et économique qui faisait dire à des Clash dépités, « j’ai été à un endroit où chaque visage blanc est une invitation au vol. »Sorti des complexes touristiques, la Jamaïque, c’est une claque dans la gueule.
À Kingston, même les hôtels sont barricadés pour protéger les étrangers, et on vous recommandera gentiment de prendre le taxi pour aller partout. Il ne fait pas bon marcher à pied, et ceux qui voudraient aller s’asseoir dans un « government yard » (cité HLM) à Trenchtown ou Tivoli histoire d’y renifler des effluves de Bob Marley le feront à leurs risques et périls. « J’y resterais bien pour faire le touriste, ajoutaient les Clash, mais les flingues c’est pas mon truc. » Une fois sorti des complexes ou des hôtels, la Jamaïque est un des endroits les plus violents du monde.
Christopher Dudus Coke
S’il en était besoin, la récente affaire Christopher Dudus Coke aura rappelé au monde entier comment ça se passe sous les tropiques. Dudus, surnommé « le Président », est un parrain de la drogue, accusé de trafic d’herbe et de cocaïne avec les USA. Le gouvernement ricain a demandé son extradition l’année dernière et avait étrangement insisté avec force en février dernier, suggérant que le gouvernement jamaïcain n’était pas tellement enthousiaste à l’idée d’extrader l’ami Dudus.
Et pour cause: son gang, le Shower Posse, est depuis les années 70 la branche paramilitaire non-officielle du parti travailliste jamaïcain, auquel appartient le premier ministre Bruce Golding, qui se trouve aussi être le député de West Kingston (où se trouve Tivoli Gardens). En plus de ses activités illégales, l’ami Dudus avait pignon sur rue avec des nombreuses entreprises légales et pour certaines financées par le gouvernement, dont Presidential Click, une entreprise de promotion de concerts et de bals ultra-populaires comme l’hebdomadaire Passa Passa ou le festival annuel Champions in Action (le festival n’aura pas lieu cet année).
Il fournissait aussi — ce qui explique le soutien phénoménal qu’il reçut de la part de la population du quartier Tivoli — des soins de santé, des aides scolaires mais aussi de la médiation dans les conflits de voisinage. La pression du grand voisin ricain a fait son effet: la police et l’armée ont procédé à un véritable carnage à Tivoli Gardens, tuant officiellement 73 personnes durant l’opération visant à capturer Dudus. Il a finalement été arrêté un mois après l’offensive alors qu’il se rendait à l’ambassade américaine.
Pour un peu, c’était The harder they come, disent ceux qui connaissent en hochant la tête, c’est pas nouveau. Le film de Perry Henzel (1972) racontait déjà la zone à l’Antillaise en suivant la survie façon Ivan, un jeune cul-terreux fraîchement arrivé dans la grande ville. Ivan s’essayait notamment au mirage de la réussite immédiate façon Studio One. On y voyait l’univers impitoyable de l’industrie du disque jamaïcaine, mangeuse d’artistes en destructrice de rêve naïf. On y voyait surtout comment l’usine à hits qu’est la Jamaïque et l’expression du mélange détonnant de vieil ordre colonial, de capitalisme tiers-mondiste et de corruption typique de la région. Dégoûté de sa carrière musicale, empêché de se ranger par nul autre qu’un prêtre, Ivan devient truand, et bientôt un Robin des Bois en herbe. Ivan finit mal: ses chefs voient d’un mauvais oeil son ambition, et Ivan s’oppose au système qui voit la police toucher sa part du trafic de drogue.
Le Robin des bois des bidonvilles finit mitraillé sur une plage de sable fin, se la jouant Django pour des caméras invisibles. Prophétique en effet, un peu comme Ivan, Dudus s’est fait choper seul et contre tous. Mais depuis le film et la bande son qui firent sa gloire en dehors de l’île, Jimmy Cliff s’est mis à la bande son Walt Disney, et la mémoire est courte. Avant de devenir le modèle de la sono mondiale, la musique jamaïcaine est le produit d’un environnement pour le moins complexe et déprimant. Voilà l’été.
Casiotone Vampaya music
Dudus s’est fait caler déguisé en femme. La photo prise par des flics qu’on devine hilares a fait le tour des journaux et du net. Le caïd en jupons, c’était fort. On s’est lâché facile, en Jamaïque, en grossissant un peu le trait, et en émettant des réserves sur la virilité de l’ancienne terreur des bidonvilles. C’est de bonne guerre, et dans un milieu vivant au rythme des hits dancehall, ça a certains relents. On s’attend à ce que les aventures du Dudus soient bientôt mises en chanson, pas forcément avec les plus belles paroles. Difficile d’aborder les musiques jamaïcaines auprès des lecteurs de Minorités sans parler des campagnes de type Stop murder music et de l’homophobie dans le genre, même si ça veut dire raconter une histoire en commençant par la fin. Réglons le compte à ce sujet une fois pour toute et passons ensuite à autre chose.
Le dance-hall, la musique digitale des années Casio, est une culture née au fil des technologies en réaction à l’internationalisation du roots and culture. [2]
Le reggae devenu une référence internationale a engendré un rejeton maudit, voix de ceux qui ne se retrouvaient plus dans les messages de paix et d’amour dumainstream reggae. Plus besoin de studio, on parle direct à la foule et on se fait jeter en direct si on n’arrive pas à retenir son attention. Comme un retour à l’envoyeur, c’est la culture bling bling et cul du gangsta rap US qui influence la rue jamaicaine et ses chanteurs slackers. Une musique basique et directe, née dans une ambiance de gangs, de sexe collectif, de crack, de trafic de coke et de consumérisme outrancier. Nihilisme versus roots reggae. Pour eux, pas de retour en Afrique, pas d’idéologie, mais le plaisir maintenant tout de suite.
Au delà de l’homophobie dans le dancehall, il faut aussi dire que les musiques jamaicaines ne trouvent pas vraiment d’oreilles favorables dans le mainstreaming LGBT : le reggae vu d’un côté (dancehall) ou d’un autre (mainstreaming LGBT) c’est pas un truc de pds.
Stop murder music
Sous l’influence d’associations LGBT, l’Europe, via l’Angleterre se penche depuis les annés 90 de manière parcellaire et caricaturale sur les paroles véhiculées par le dancehall : les babas cools bobos tombent des nues devant les titres et paroles violemment homophobes, et les annulations de tournées, arrestations de chanteurs et refus de visas s’accumulent pour les stars du dancehall.
Teintée de mépris de classe, de caste (à part dans les milieux jamaïcains londoniens, vous avez déjà vu des soirées LGBT où le raggaton fait vibrer le dancefloor sous les hourras des clones, bears et travestis ?) et parfois tout simplement de racisme primaire, ces condamnations aussi caricaturales que localement nécessaires n’influencent qu’une partie de la carrière internationale des chanteurs Beenie Man, Sizzla, Elephant Man, Vybz Kartel et autres Bounty Killer. Car l’aura des petits rejetons malsains de la maison reggae et son importance pour l’industrie musicale et son économie ne se limite pas aux rives européennes.
Comme le répètent souvent les artistes eux-même, du Moyen-Orient à l’Asie, l’Afrique et l’Indonésie, ces discours trouvent ailleurs des oreilles et un marché qui n’ont que faire de ce type de condamnation et qui s’en tapent des associations de droits humains. En Jamaïque, ces campagnes ont un effet pervers, celui de susciter un débat qui, au lieu de servir les droits des LGBT locaux, renforce leur exclusion et freine l’avancée de leurs droits.
Les jamaïcains, à l’esprit revêche, ne sont pas prêts à recevoir des leçons culturelles et morales d’occidentaux après avoir subi esclavage, exode migratoire massif, et leçons économiques catastrophiques du FMI. Mal placés, le nationalisme et la fierté jamaïcains, certainement.
Mais cela n’étonne que les observateurs lointains, influencés par les resucées de reggae à la sauce française qui de Gainsbourg à Tryo en passant par Cookie Dingler fatiguent les oreilles délicates. La Jamaïque contemporaine est une société contrastée, rongée par la pauvreté et l’influence de multiples tendances religieuses, souvent radicales et éloignées de l’oecuménisme de la façade reggae des années 70.
La rhétorique brutalement homophobe du dancehall est un écho en feedback de ce discours public, où l’on fait la guerre aux dealers pour mieux ignorer la corruption des institutions, et où l’on fait de l’homosexualité un produit de cette même influence occidentale/US contre laquelle on ne fait rien politiquement.
Bruce Golding, premier ministre du Jamaica Labour Party (JLP – parti de droite, malgré le nom), s’est ainsi aussi fait un nom comme le grand défenseur de la Jamaïque contre ce qu’il appelle la fraternité homosexuelle. Edward Seaga , du même parti a même utilisé le morceau éminemment homophobe Chi Chi man de T.O.K. comme chanson d’ouverture de ses meetings.
Reprenant à la sauce parlementaire les arguments des chanteurs de dancehall, Golding s’opposait encore récemment a d’éventuels changements de la législation jamaïcaine en faveur des homosexuels.
« Il y a des pays qui sont prêts à trahir tradition et culture pour ce qu’ils considèrent être des libertés individuelles, et sont prêts a faire ceci pour la fraternité homosexuelle qui est une minorité de leur population. Ce comportement prévaut en Europe. »
Golding soutient une espèce de don’t ask don’t tell national, ou l’homosexualité n’est pas un problème tant qu’elle reste une pratique privée et invisible en public. C’est une position qui n’est pas sans rappeler les conclusions tirées d’une visite personnelle dans les quartiers de VP records à Jamaica, Queens, New York d’où nous avions ramené des piles de mixtapes de clashs, des albums de Sizzla ou de Lady Saw, des compiles Strictly the best etc…
Les communautés homosexuelles d’origine non européennes privilégient par sens de la survie le don’t ask don’t tell pratiqué dans leurs pays d’origine. Mais c’est précisément dans l’espace à double sens entre les cultures occidentales et les cultures caribéennes que foisonnent les plus grands changements et les pires incompréhensions.
Une vision littérale de Sodome et Gomorrhe
En effet, l’homophobie dans l’expression musicale rasta n’est pas une nouveauté. Un groupe comme Bad Brains s’est fait « virer » de la scène punk hardcore de Washington DC après notamment une altercation avec les Big Boys, un groupe punk gay [3]. Les chansons « How low can a punk get » et « Banned in D.C. » racontent ces évènements. Pour H.R., c’est un mélange de jeunesse inculte, la confrontation entre leur mode de vie et celui de jeunes gays – deux mondes qui au mieux s’ignorent au pire se méprisent l’un l’autre et leur zèle de jeunes rastas qui est à l’origine de leurs prises de positions. La Babylone de l’Apocalypse et Sodome et Gomorrhe de la Genèse finissent dans un brasier ardent et les zélotes combattent romains et coreligionnaires timorés.
Ce sont des déclarations d’homophobie crue qui ont entrainé la chute dans l’oubli de Shabba Ranks, une des premières grandes stars internationales du dancehall. Sa réaction à l’outrage occidental aura été d’abord de sortir sa bible et d’en citer des passages pour justifier sa position, puis de négocier avec des assos LGBT. Il en rencontra et fourni des excuses officielles. Ces excuses furent très mal perçues en Jamaïque et il semblerait que ses tentatives d’ouvertures aient jeté un discrédit national total sur sa musique.
À l’international, ce fut son boycott et son renvoi de sa maison de disques suite à ses prises de position qui signèrent l’arrêt de la carrière du loverman. L’erreur serait de voir une homophobie intrinsèque, inévitable, inévitablement culturelle. L’article qui cite Golding mentionne aussi un psychologue jamaïcain, Sydney McGill, pour qui les sorties de Golding témoignent aussi d’un changement des moeurs et coutumes jamaicaines:
« Les homosexuels dans la communauté jamaïcaine se sont donné comme mission de sortir du placard collectivement. Il y a des communautés homosexuelles attachées à des gangs et qui sont protégées à différents niveaux par des gangs, ce qui leur permet de sortir sans trop avoir peur. »
Si l’homophobie est endémique en Jamaïque, c’est aussi parce qu’elle se reproduit au gré d’intérêts politico-culturels aussi complexes que l’histoire de l’île. Mais le fil rouge de la culture jamaïcaine c’est la violence sous toutes ses formes, présente en filigrane dans les musiques jamaïcaines depuis les années 50 et les early sound clash.
Les sound systems et la violence
L’exemple le plus connu, c’est le skinhead reggae. Mode vestimentaire et culturelle sur fond de soul et de rhythm ‘n blues américain puis de calypso et dépendances caraïbes, la culture du skinhead est une invention jamaïcaine qui se dissémina en Angleterre via la culture ouvrière, les usines, l’armée et les sorties des prolo. Fashion, music and lifestyle. Du sound system parti de la boutique d’alcool de Duke Reid The Trojan aux « clashes » contemporains, c’est sur fond de pègre, de couteaux agiles et de politique volatile que se bâtit toute une frange de la culture populaire jamaicaine.
Expression des milieux ouvriers, les soirées des sound systems furent dès cette période prétextes à de violentes descentes de police.
Animés par des DJs maniant aussi bien l’insulte que le vinyl, les soirées sound systems font et défoncent les modes et réputations musicales; mais elles sont aussi des espaces d’expression sociale et politique, ou l’on dénonce les abus policiers et les magouilles politiques.
La société jamaicaïne marquée par une histoire de révoltes, d’insurrections et de répressions sanglantes, accouche dans les années 60 de son rejeton urbain, le rudeboy des bidonvilles, prêt à jouer du couteau puis du calibre pour n’importe quelle raison, la défense de son posse, de son sound system, de son quartier. Souvent sans emplois ni qualifications, désabusés, si ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la société ilienne, ils deviennent suffisamment nombreux et bruyants, se reproduisant à l’infini jusqu’à leurs petits enfants aficionados du dancehall.
Voyous au style impeccable inspiré des films de gangsters américains, souvent sans emplois ni qualifications, les rudeboys deviennent au sound system ce que les apaches furent au bal musette. Les flingues remplacent les lames, les partis politiques se disent qu’il y a un coup à jouer, et dans les années 70 le mélange explosif entre musique, politique et gangstérisme décrit indirectement dans The Harder They come est parachevé.
S’ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la société ilienne, les rudeboys sont néanmoins nombreux et bruyants, et se reproduisent à l’infini jusqu’à leurs petits enfants aficionados du dancehall.
Une culture de consommation …
Pendant ce temps, de l’autre côté de l’Atlantique, les immigrants jamaicains amenaient cette culture dans leurs bagages dans l’Angleterre d’après-guerre. La discrimination dans les bars des années 50 y ajouta une couche toute britonne: les bars et soirées étaient souvent interdits aux Noirs, aux chiens et aux Irlandais. C’est par ces derniers et quelques bourges en goguette que se diffusa progressivement dans les classes populaires blanches la culture rude boy, sa musique mais aussi son attitude et style vestimentaire marqué. Les mods furent totalement séduits et the rest is history: le ska et le rocksteady sortent des banlieues jamaïcaine pour envahir les clubs du centre de Londres.
Des versions acidulées commeMy boy lollipop détronent les Beatles dans les charts, et bientôt le beat se ralentit, et les paroles, sur fond d’indépendances et de tiers mondisme, tournent au nationalisme noir et à la promotion du rastafarisme. En attendant, le style skinhead reggae marque durablement la culture anglaise, des chemises Ben Sherman aux polos Fred Perry, des Clarks (chères à Vybz Kartel) aux MA1 flights jackets (bombers), les jeans serrés, les combat boots, les treillis (merde on dirait des photos de jeunesse de Lestrade).
La liste s’allonge comme dans un bouquin de Bret Easton Ellis : Brutus Trimfit, Lonsdale, Everlast, Harrington, Adidas, Riddim driven, un catalogue de signes extérieurs de faiblesse qui relient les jeunesses désoeuvrées adeptes de haine cathartique du soleil des Caraïbes aux nuages de London. À cette base de départ, le dancehall ajoute le tuning de bagnoles, les sonos en mode Pimp my Ride, les nanas aux seins gonflés à l’hélium, les chaînes dorées du gangsta rap et les baggy pour cacher son coutelas cubain.
…et de compétition
Vybz Kartel (qui a été entendu par la police jamaïcaine il y a quelques jours et a fait les une de la presse de l’île) est quant à lui interdit d’exportation et vit très bien sa vie d’artiste en se basant sur sa réputation locale, les mixtapes et les fans de dancehall wherever they are.
La rivalité qui l’a opposé à Mavado a été le point de départ d’une véritable guerre de quartiers entre Kingston’s Gully (Mavado) et Portmore’s Gaza (Vybz), entre soutiens du JLP et du People National Party (PNP, de gauche), deux partis politiques opposés. Résultat: coups de feu, attaques de touristes, violences dans les écoles… La guerre continue cette année entre Vybz et Black Rhino. Fusillades, mort. Vybz est actuellement entendu par les autorités jamaicaines après la fermeture de son studio d’enregistrement. Le déroulement même des soirées dancehall oblige à la surenchère verbale, et attise la violence des fans prompt à défendre la réputation de leur territoire, de leur parti…
Pour que la foule réagisse au DJ, et lui réponde par unforward, bras en l’air et briquets allumés, il se doit de surpasser le précedent avec le langage le plus cru, le plus sexuel, dénonçant de manière outrancière tout et n’importe quoi, des indics au sexe oral. Régulièrement dénoncé par les autorités pour la verdeur de ses textes, le dancehall est pourtant, dans un pays pétri de religion, de sectes dynamiques et de spiritualités radicales variées une sorte de haut-parleur moral des aspects les plus conservateurs de la culture de l’île.
Le langage des chanteurs de dancehall comporte de nombreuses créations, de sorte à masquer la teneur de son contenu, mais aussi de singulariser, affirmer et autonomiser la langue populaire jamaïcaine, le patwa.
Les clash utilisent la compétition à outrance, utilisant des tenues et vocabulaires guerriers qui échauffent les esprits prêts à en découdre dès le plus jeunes âge (de nombreuses agressions ont eu lieu dans les écoles suite au clash Vybz/Mavado entre fans des deux artistes). Le kill scandé par le DJ face à son adversaire musical est pris au sens littéral. Gare à celui qui joue un mauvais morceau au mauvais endroit.
Peu à peu la culture du rudeboy et du clash, accompagnant la pauvreté endémique de la majorité de la population de l’île ronge la vie des quartiers populaires jamaïcains, alors même que le dancehall se propage, dans une incompréhension majeure de ses racines et de ses textes, de par le monde.
[À suivre…]
Peggy Pierrot
Notes
[1] Grégory Pierrot est étudiant en doctorat en anglais et réside dans le coeur du coeur de l’Amérique, où il prépare en douce son offensive sur le monde entier.
[3] Sur la culture reggae lire l’indispensable Bass Culture, de Lloyd Bradley.
[3] Voir l’interview de H.R. sur Pitchfork.